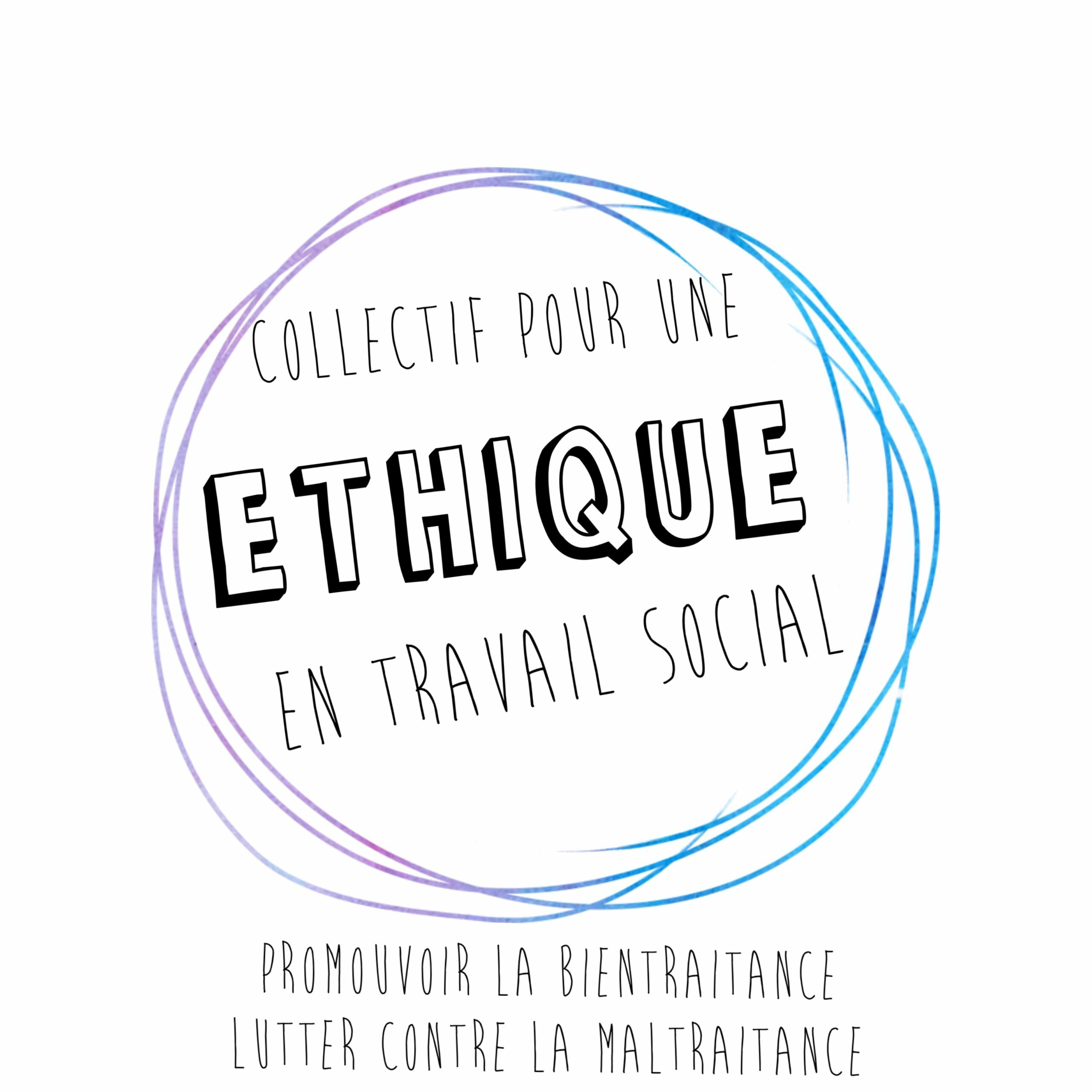Éthique et institution
L’un des principes fondamentaux de la modernité pose que « la Solidarité est l’affaire de la Nation ». Enoncé par les philosophes des Lumières dès le dix-huitième siècle, ce grand principe vise à dépasser ceux définis par la seule Charité, pour offrir une réponse par la collectivité aux besoins de chaque citoyen. Qu’elles peuvent être, au tournant du premier quart de ce 21° siècle, les facteurs limitatifs ou invalidants, qui s’opposent à la réalisation par la collectivité des besoins des citoyens ?
Une éthique basée sur le respect de la mission du Travail Social
A cause de nombreux soubresauts de l’Histoire, ce n’est qu’à partir de 1945 que le démarrage exponentiel d’une véritable Solidarité instituée s’est effectué. Elle s’est construite selon 2 grands axes : celui de la Protection Sociale, sous forme de redistributions allocatives, et sous celui de l’Action Sociale, qui permet d’offrir un Accompagnement Socio-Educatif aux citoyens les plus fragilisés. Cette Action Sociale a alors pu être dénommée également « Travail Social », parce que l’exercice de cette Solidarité se voyait désormais effectuée essentiellement par des salariés regroupés dans des institutions spécialisées.
L’éthique principale de ces institutions spécialisées consiste à réaliser au mieux leur mission. Mais, étonnamment, cette mission n’a été définie que tardivement dans le cours de la construction du secteur. Le décret du 6 mai 2017 énonce que « le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. »
Cette définition peut bien sûr être critiquée, mais elle a au moins le mérite d’exister dorénavant. De manière tangible, parler d’éthique en travail social, c’est repérer et lutter contre les facteurs limitatifs ou invalidants de cette mission, telle qu’elle est définie dans le décret et telle qu’elle devrait s’imposer dans les institutions en travail social.
Une démarche de repérage des catégories limitatives ou invalidantes
Le livre « Alerte ! », qu’au sein du Collectif pour une Ethique en Travail Social nous avons fait paraître il y a quelques années, nous a permis de repérer 2 grands caractères socio-historiques dans la construction du Travail Social. Il y a tout d’abord son caractère inachevé, qui voit les dispositions et les dispositifs venant accompagner les personnes ne pas forcément couvrir tous leurs besoins. De plus, le Travail Social se trouve désormais menacé, depuis l’instauration des politiques d’austérité au tournant des années 90 et de l’entrée dans le nouveau siècle.
Le livre « Alerte ! », à travers les différents témoignages qu’il avait collationnés, donnait à voir des situations, où l’éthique était maltraitée, mais n’avait pas renseigné sur les catégories limitatives ou invalidantes, qui s’exprime dans les différentes institutions du Travail Social. Ce texte aujourd’hui va essayer, certes de manière très sommaire et empirique, de repérer ces catégories. De manière plus académique, nous dirions qu’il s’agit de l’amorce d’une typification, qui demanderait bien sûr à être croisée avec une enquête rigoureuse pour en vérifier les catégories possibles. Pour chacune des 6 catégories proposées ci-dessous, nous offrirons l’exemple d’un ou 2 marqueurs pour bien comprendre ce dont il s’agit.
Une construction du Travail Social inachevée
Concernant la dimension inachevée du Travail Social, 3 catégories peuvent apparaître. Il y a tout d’abord un déficit de professionnalisation : actuellement 40 % du personnel est en situation de « faisant fonction ». Les professionnels sont soit non diplômés, soit possédant un diplôme inférieur à celui nécessaire pour exercer la fonction : le chef de service est par exemple un ancien éducateur ne possédant pas de diplôme lié à sa fonction d’encadrement.
Ce déficit de professionnalisation s’exprime également par un défaut de reconnaissance de la singularité des personnes : l’institution a parfois du mal à réaliser des projets réellement personnalisés et effectivement mis en œuvre. Elle peut alors se retrouver surtout à gérer le flux de ses entrants et de ses sortants, dont elle aimerait standardiser les besoins pour en faciliter la gestion.
Deuxième catégorie repérée : la question de la déresponsabilisation. Pour améliorer en permanence l’offre de service d’une institution et l’adapter aux réalités vécues, il faut d’abord accepter de regarder les limites de cette institution, pour réformer ensuite les pratiques et le projet institutionnel. Or il existe parfois beaucoup de difficultés à pouvoir reconnaître en interne, de la part du personnel comme de celui des membres du Conseil d’Administration, les limites de l’institution, parce qu’elles engagent également la responsabilité de chacun. On peut même dans certains cas parler de dissimulation généralisée, non pas parce que tout est dissimulé, mais parce que toutes les catégories d’acteurs, des membres du Conseil d’Administration ou des cadres de direction jusqu’aux opérateurs terrain, vont avoir tendance à dissimuler les situations les plus délicates et leurs difficultés à y répondre.
Pour réaliser cette dissimulation, il est souvent repéré l’exercice d’une double boucle défensive, qu’on peut résumer ainsi : « esquiver et masquer l’esquive ». Pour n’en donner qu’un marqueur : une situation n’a pas été abordée ou très mal en réunion institutionnelle et a donc été esquivée. Cette esquive pourra être masquée, parce que le compte-rendu de la réunion aura fait sciemment l’impasse sur ce point de débat ou le rapportera de manière très euphémisée.
Une troisième catégorie concerne les freins possibles à l’émancipation. On peut notamment dans ce cadre-là évoquer l’existence d’un risque de positionnement de classe des encadrants par rapport à la population : les travailleurs sociaux, membres essentiellement des classes intermédiaires, peuvent chercher plus ou moins consciemment à se distinguer des classes sociales inférieures ; en foyer d’insertion, permettre l’accès à un logement social de manière prioritaire pour les hébergés peut heurter dans certains cas des travailleurs sociaux, en situation de travailleurs très modestes, voire pauvres, ayant leurs propres difficultés, notamment d’accès à un logement décent. De ce fait, ils peuvent avoir du mal à s’investir pour faire valoir les droits des hébergés.
Un Travail Social menacé
Pour appréhender les catégories, qui peuvent concerner le Travail Social menacé, nous nous baserons sur les travaux réalisés par le Collectif des Associations Citoyennes, auquel adhère le CETS, et dont les grilles concernant l’ensemble du secteur associatif couvrent bien sûr la question des institutions en Travail Social.
Dans leur repérage des catégories mobilisables par l’observation des actuelles politiques néo-libérales et austéritaires qui menacent le monde associatif, il y a tout d’abord la question de la marchandisation : l’entrée en force du privé lucratif dans le secteur de la solidarité n’introduit-il pas des biais terribles à l’encontre des personnes accompagnées au nom de la rentabilité ? Les 2 livres récents de Victor Castanet, « les fossoyeurs » consacré au monde des EHPAD privés et « les ogres » à celui des crèches également privées, sont terriblement révélateurs des violences faites aux personnes, au nom d’une maximalisation du profit.
Il faut aussi parler de ces fameux investissements à impact, qui commence à se développer de plus en plus dans les pays développés, qui voient des fonds d’investissement, en recherche bien sûr de rentabilité, se substituer, avec la complicité des pouvoirs publics, a la bonne vieille subvention publique du secteur de la Solidarité. Le coût global de ces investissements à impact – études, montage et prise de bénéfice -vient doubler le coût de l’action en elle-même, tout en réduisant le pouvoir de décision de l’association opératrice.
Autre catégorie : celle visant la question de la managérialisation. On entend par là essentiellement le fait, que les pouvoirs publiques viennent définir les critères d’évaluation des institutions, afin de favoriser le paiement à l’acte, moins coûteux pour les tutelles. Ils imposent de ce fait aux cadres du secteur de conditionner l’exercice du travail social par les opérateurs de terrain, aux seuls items d’évaluation créés de manière surplombante. En Wallonie, la partie francophone de la Belgique, la loi décrète que les institutions du secteur de la Solidarité doivent avoir des critères d’évaluation de leurs actions, mais laisse aux institutions, à l’intérieur de leur propre processus décisionnel, le choix de ces critères, forcément plus proche de la réalité de l’exercice de leur travail que les critères descendant de l’évaluation en France.
Enfin il existe une ultime catégorie : celle de la répression. Ne serait-ce que dernièrement par l’apparition du Contrat d’Engagement Républicain, que doivent signer les institutions en Travail Social pour pouvoir être subventionnable. Il a été dévoyé de son intention première, qui était de faire respecter le principe de laïcité. Désormais le préfet peut bloquer les subventions à toute institution, qui lui semblerait sortir des canons de la conception française, républicaine et centralisée, de l’organisation de la Solidarité. Une association de soutien aux migrants peut s’attirer les foudres du préfet, si elle en vient à soutenir humainement des franchiseurs illégaux de frontières entre l’Italie et la France ou entre Calais et Douvres.
Ce climat répressif imprègne les esprits et auto-limite l’intervention des travailleurs sociaux. En France, il serait inconcevable qu’un éducateur en club de prévention rapporte que dans le cadre de son activité, il aurait participer avec un groupe de sans-abris à l’occupation d’un bâtiment vide pour le squatter. L’illégalité de cette action constituerait le facteur premier de son appréciation. A contrario, en Belgique, cette action serait considéré comme un marqueur positif de l’activité de cet éducateur, au nom de l’inconditionnalité de la Solidarité.
Toujours dans ce climat répressif, au CETS, nous avons repéré, qu’il existe malheureusement nombre de situations de maltraitance envers les usagers, mais qui s’accompagnent de malmenance envers les salariés, notamment ceux qui souhaitent alerter sur les maltraitances ou l’insuffisance de bientraitance vécues par les personnes. Cette malmenance est basée sur une volonté de faire régner une véritable omerta : mieux vaut une injustice qu’un scandale.
*
Ce début de typification est éminemment critiquable et à vocation à l’être librement. Mais ce court article doit pouvoir créer la base d’une réflexion pour savoir, si le secteur se retrouve dans les 2 grandes dimensions proposées – inachevé et menacé – et dans les 6 catégories exposées, concernant les limitations ou les invalidations que subissent le secteur.
Il est absolument nécessaire de pouvoir faire ce travail, parce que lorsqu’on se heurte à un phénomène, il faut d’abord pouvoir sortir de l’indistinct et définir l’existant. C’est donc en avançant dans la caractérisation du phénomène, qui ronge notre positionnement éthique de ce que devrait être le Travail Social, que nous pourrons alors mieux concevoir les alternatives à créer : que ce soit dans les pratiques au quotidien à l’intérieur des institutions, comme dans l’environnement institutionnel du secteur, en modifiant ses règles et ses lois, pour le rendre plus humain et plus juste.